 Marie de Hennezel le dit à quelques reprises : chaque accompagnement d’une personne mourante qu’elle a réalisé était une aventure. Une aventure humaine, incarnée et spirituelle. Lire ‘La mort intime’ en est une également. Plus légère, plus désincarnée, plus solitaire aussi. Plusieurs fois, vous sentez cette boule qui monte soudainement, des tripes à la gorge. Pourtant, vous n’êtes qu’un lecteur. Mais les situations qu’elle décrit déclenchent un flot mêlé d’émotions : admiration pour les soignants, pour la sagesse de certains mourants, la beauté de ce que vivent d’autres, effroi peut-être devant les symptômes ou maladies dont ils sont affligés, angoisse aussi devant sa propre mort. Ce sont des émotions véritablement mêlées, imbriquées, émotions simultanées. Et puis vous vient cette étonnante pensée-la, fugitive, certainement scandaleuse pour les malades et pour leurs proches : « j’aimerais bien… mourir comme ça« .
Marie de Hennezel le dit à quelques reprises : chaque accompagnement d’une personne mourante qu’elle a réalisé était une aventure. Une aventure humaine, incarnée et spirituelle. Lire ‘La mort intime’ en est une également. Plus légère, plus désincarnée, plus solitaire aussi. Plusieurs fois, vous sentez cette boule qui monte soudainement, des tripes à la gorge. Pourtant, vous n’êtes qu’un lecteur. Mais les situations qu’elle décrit déclenchent un flot mêlé d’émotions : admiration pour les soignants, pour la sagesse de certains mourants, la beauté de ce que vivent d’autres, effroi peut-être devant les symptômes ou maladies dont ils sont affligés, angoisse aussi devant sa propre mort. Ce sont des émotions véritablement mêlées, imbriquées, émotions simultanées. Et puis vous vient cette étonnante pensée-la, fugitive, certainement scandaleuse pour les malades et pour leurs proches : « j’aimerais bien… mourir comme ça« .
Marie de Hennezel a rejoint en tant que psychologue l’une des toutes premières équipes de soins palliatifs. Elle l’a rejoint au pire moment de l’épidémie de sida. C’est dire que, parmi d’autres personnes malades, elle a accompagné beaucoup d’hommes, et quelques femmes, jeunes.
Marie de Hennezel raconte. Elle témoigne.
De ces instants que d’aucuns voudraient abréger et durant lesquels se vivent des évolutions insoupçonnables. Ces moments éphémères durant lesquels certains vont enfin se révéler, se montrer en vérité, offrir leur sensibilité, oser la tendresse, et puis veiller inexplicablement jusqu’à pouvoir mettre leur vie « en règle » : en disant au revoir à une personne perdue de vue, en retrouvant des enfants négligés, en s’acceptant in extremis eux-mêmes.
Imaginons-nous seulement ce que peut attendre une personne qui agonise ? Marie de Hennezel raconte le cas de Marcelle, femme âgée qu’elle a vu la première fois comme une forme avachie dans un lit, en pleine confusion mentale, échevelée, tentant d’enjamber les barrières qu’on avait mises à son lit. Chaque fois que sa fille entendait, dans le flot incohérent de ses paroles, le mot « mourir« , elle la reprenait, lui affirmant qu’elle était là pour qu’on la soigne, et pour guérir. Une soignante et Marie de Hennezel lui demandèrent de lui accorder un instant seules avec sa mère. Celle-ci s’est alors tournée vers la soignante : « je vais mourir« . L’infirmière lui répondit : « nous serons là jusqu’au bout« . Marcelle, « à [leur] grande surprise« , s’est alors redressée. Elle a fait entrer sa fille, et lui a dicté ses dernières volontés.
Marie de Hennezel raconte le départ de Louis, homme d’une quarantaine d’années, malade du Sida, vif d’esprit, que sa femme désespérait de voir partir dans un état confusionnel, mais qui a pu recouvrer ses esprits lorsque sa femme a enfin pu faire comprendre et admettre son état à sa famille, avant de mourir, dans sa dignité.
C’est aussi le départ de Jean, mort en dansant dans les bras de son ami : « « Danse, danse « , répétait son ami, tandis que leurs bras réunis se berçaient de gauche à droite. Et puis Jean a souri, un sourire magnifique, sublime, avant de s’effondrer sur l’oreiller. Il venait de rendre l’âme en dansant ».
Elle évoque le cas de Marie-France, qui a demandé la mort dès son arrivée. Mais dit-elle
« aussi bien accueillie que je le suis, je n’en désire pas moins mourir le plus vite possible (…) Mais le médecin ne veut pas entendre cela. Il me dit qu’il faut attendre que la mort vienne à son heure. Je ne vais tout de même pas attendre des années. » « Croyez-vous vraiment, lui dis-je en lui prenant les mains et en la regardant droit dans son seul oeil visible, un oeil intelligent et pétillant, croyez-vous vraiment que cela peut durer des années ? N’avez-vous pas constaté à quelle allure la maladie progresse ? Pourquoi resteriez-vous en vie si vous avez le sentiment que votre vie est finie ? »
« Pourquoi resteriez-vous en vie si vous avez le sentiment que votre vie est finie ? » Bien sûr, on peut imaginer, sans certitude toutefois, qu’il y ait des cas dans lesquels une telle idée n’a pas cours. Mais c’est une idée commune à nombre des rencontres rapportées par Marie de Hennezel. Nombreux sont ceux qui, attendant la mort, ne la trouvent qu’après avoir réglé un point, du plus concret au plus métaphysique. Dire au revoir, notamment. Marie de Hennezel raconte le départ de cette toute jeune femme pleine de courage, tombée dans le coma aux soins palliatifs, qui ne réagissait plus à rien depuis trois semaines. Marie de Hennezel et ses proches cherchaient ce qui la retenaient. Ses parents et un bénévole sont venus un jour, pour lui dire tout leur amour, lui dire qu’ils la remerciaient pour ce qu’elle leur avait apporté, et qu’ils la bénissaient. Elle a ouvert les yeux et, dans un geste qui lui était familier, a agité sa main en leur disant « ciao« . « Et son souffle s’est suspendu sur ce dernier au revoir. C’était fini »
Marie-France, elle, quelques jours plus tard, disait à un soignant :
« Il a fallu que j’en arrive là pour découvrir que la bonté existe »
Aurait-elle du mourir avant de le découvrir ?
Car ce que le livre de Marie de Hennezel rapporte, c’est aussi cela, que la bonté existe. Et qu’il ne faut pas négliger ce temps, le temps de mourir.
Le temps, et la bonté.
La bonté, évidemment, des soignants. Car les soins palliatifs, ce n’est pas seulement un lieu de soins médicaux. C’est aussi le lieu de toutes les attentions, un lieu où l’on respecte la personne, le temps qu’il lui reste, le temps qu’il lui faut. Un lieu où la personne malade n’est pas abrutie de médicaments, par défaut, parce que le personnel n’est pas formé, parce qu’il n’a pas le temps de s’occuper pleinement du malade, parce qu’il est en sous-effectif.
La bonté, ce sont évidemment les soins, apportés dans le souci de la dignité de la personne, parce que les soignants les apportent avec délicatesse et attention. Marie de Hennezel souligne l’importance du toucher. Quand certaines infirmières, dans des services classiques laissent la personne en vrac, là, elles la laissent en paix. La bonté, c’est celle de cette infirmière qui prend le temps de créer un ambiance de fête et d’apaisement, avec deux bougies, pour une patiente qui hurlait d’angoisse la nuit. Les médecins avaient remarqué qu’avec cette infirmière, le nombre d’antalgiques prescrits la nuit chutaient considérablement.
La bonté, c’est cette maison, tenue par des religieuses au Canada, pour les malades du Sida en phase terminale. Avec ces attentions, maintenues malgré leur inutilité apparente, comme de créer une belle assiette, harmonieusement disposée, pour des malades qui ne peuvent plus rien avaler, mais qui ne manqueraient en aucun cas ces temps de repas en commun.
Le temps, c’est ce dont ces malades disposent le moins, ce dont leurs soignants disposent, ce qu’ils leur offrent, ce qu’ils respectent. Donner et laisser au malade le temps de mourir.
Et ce temps est précieux. Ce que le livre de Marie de Hennezel permet aussi de découvrir, c’est bien que ce temps de l’agonie n’est pas condamné à être un temps d’attente et de douleur. Un temps inutile et absurde durant lequel l’homme n’a plus rien à construire, plus rien à bâtir. Durant cette agonie, qui fait donc partie de la vie, l’essentiel peut encore se produire.
C’est aussi Charlotte…
« Charlotte s’est blottie davantage encore dans mes bras. Elle me dit qu’elle sent une douce chaleur en elle, une envie d’aimer : « je sens que j’ai encore beaucoup d’amour à libérer » « C’est cela qui va t’aider, ma chérie, tu ne peux plus faire grande-chose dans ton lit, mais manifester cet amour que tu sens en toi, ça tu peux le faire »
Et Danièle, frappée d’un locked-in syndrom :
« Le bonheur, ça vient sans crier gare, jusques et y compris où sévit la maladie »
Donner du temps, respecter ce temps. L’auteur de cette phrase un peu incongrue en politique, « donner du temps au temps« , préface ainsi l’ouvrage de Marie de Hennezel :
« Jamais peut-être le rapport à la mort n’a été si pauvre qu’en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d’exister, paraissent éluder le goût du mystère. Ils ignorent qu’ils tarissent ainsi le goût de vivre d’une source essentielle »
A cette phrase fait écho, celle de Louis :
« Me serrant fort contre lui, il me dit : « Tu sais, Marie, il n’y a rien à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre, tout est mystère. Il faut seulement vivre ce mystère ! » »
Vivre le mystère de la mort. C’est une idée facile à formuler pour qui est en bonne santé. Mais ce n’est pas une idée à exclure. Non, ne pas exclure, parce que nous sommes pressés d’exister, parce que nous ne fréquentons plus la mort que de faits divers en appels médiatiques, et qu’elle nous terrifie à mesure que nous nous étourdissons, ne pas exclure que, dans ce moment ultime, il puisse se vivre encore quelque chose, de l’ordre du mystérieux, et du magnifique.










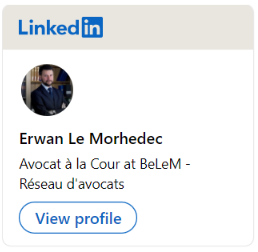


Merci.
Comme ça, à froid, dés le matin, lire cet article me laisse sans voix.
Oui, on aimerait mourir ainsi.
Bon, je me suis dit que je ne le disais pas beaucoup (s’pas). Donc, Koz, c’est pour des billets comme celui-là que j’aime bien te lire.
Mais bon, à part : laissons les gens accéder au droit d’être soignés dignement jusqu’au bout… il n’y a pas grand chose à dire.
Merci KOZ de cette réflexion sur la fin de vie et de cette très large référence au livre de Marie de Hennezel que j’ai lu et beaucoup aimé aussi. Ce regard sur la fin et de vie est un regard sur la vie tout court, regard qu’il faut diffuser dans la société. La loi Léonetti permet que cette approche soit vécue dans un cadre légal satisfaisant et avec des moyens qu’on aimerait plus importants. Les poussées actuelles en faveur d’une « exception d’euthanasie » ou d’une « déresponsabilisation pénale » nient complètement tout ce qu’expose Mme de Hennezel. Merci encore
Effectivement, la mort est escamotée dans notre société, d’autant plus quand elle intervient au bout d’une interminable vieillesse, et toutes les pubs qui nous conditionnent expliquent que la vieillesse et ses signes, sont l’échec par excellence.
La mort ne se résume pas aux quelques instants ou aux quelques jours qui précèdent le dernier souffle, c’est un processus qui se met en place, un lent apprivoisement.
Jeunes, nous avons l’illusion de l’immortalité et les plus âgés nous entourent et nous protègent, puis les rangs s’éclaircissent, les parents meurent et nous laissent en première ligne.
Ces pertes et ces chagrins font partie du chemin vers notre mort, mais encore faut-il ne pas esquiver cette forme de méditation qui devrait les accompagner.
Les hommes ont besoin de spiritualité pour vivre et pour mourir, à travers la religion mais pas exclusivement.
Les témoignages rapportés donnent à réfléchir sur la manière dont les hommes peuvent aborder la mort.
Je suis moins convaincue par toute cette « bonté » de la part des accompagnants, il suffit d’avoir fréquenté un peu les hopitaux et les maisons de retraite pour relativiser cette bonté dont d’ailleurs il n’est pas nécessaire de faire preuve je crois; du respect, de l’écoute suffisent.
L’amour et les mots pour le dire, il revient aux proches de les exprimer, il leur faut donc être là et se confronter à tout ce à quoi ils essaient d’échapper dans la vie » normale »
Il y a quelque chose qui me dérange dans ce message qui consiste à dire qu’il faut réussir sa mort, comme il faut réussir son mariage ou sa sexualité, même si ce n’est pas le message de M.de Hennezel, il y a de ça quelque part…
Je trouve nécessaire de remettre la mort dans le monde des vivants mais sans imposer ce qui est bien ou mal, ce qu’il est bien de faire ou d’éviter, juste en laissant chacun faire comme il peut et en l’accompagnant.
Que l’on soit patient, proche d’un patient ou accompagnant, on pourrait dire comme P. Roth dans « un homme » : »parce que l’expérience la plus intense, la plus perturbante de la vie, c’est la mort. »
Je voudrais juste souligner qu’il n’est pas facile pour un proche de patient de faire tomber les masques de la peur (devant la maladie)et de la pudeur (par rapport au vécu avec cette personne) et il me semble qu’un des aspects essentiels du « travail » remarquable des accompagnants, c’est de faire un pont entre les patients et leurs proches pour libérer les paroles et les gestes.
Très beau billet Koz, sensible et juste mais trop remuant
Certes, Lisette. Mais il faut le dire, l’illustrer et, il me semble, tenter de faire comprendre que l’on prend un risque à accéder à une demande de mort : celui que cette demande signifie autre chose.
Il me semble que notre société pressée a besoin qu’on le lui rappelle.
Je n’ai pas voulu, Dominique, polluer ce débat avec des réflexions acrimonieuses mais j’ai lu une certaine tribune hier dont la richesse de la réflexion et la sincérité du propos ne m’ont pas éblouies. Je me suis retenu de l’évoquer.
Marie de Hennezel ne dit pas, et moins non plus, que tous les soignants fassent preuve de bonté. On peut au moins retenir au crédit de la plupart que c’est un travail dans lequel on prend soin de l’autre.
Elle évoque précisément les soignants dans les services des soins palliatifs. Le fait que leur travail soit apprécié sur d’autres critères que la rentabilité et le nombre d’actes effectués en une heure leur donne probablement plus de chances de développer leur bonté naturelle.
A mon sens, Carredas, il ne s’agissait pas de dire qu’il faut réussir sa mort. Juste prendre conscience qu’il peut encore s’y dérouler quelque chose et que c’est donc un moment à « soigner ».
Il me semble que c’est l’esprit dans lequel c’est fait. A en lire « La mort intime », et à en écouter des praticiens des soins palliatifs (dont une amie, perdue de vue, mais qui m’en avait longuement parlé il y a déjà quelques années)
Ca apparaît plusieurs fois dans le livre de Marie de Hennezel, effectivement. J’avoue avoir trouvé utile également de lire ce livre pour espérer mieux réagir le jour où je serai confronté au décès d’un proche. Evidemment sans garanties.
Après de tels extraits, on se dit que, probablement, beaucoup de malades qui réclament l’euthanasie le font par peur de mourir seuls, sans tendresse, sans attention.
Ca a l’air d’être un livre vraiment magnifique et qui évite toute sensiblerie. Je cours l’acheter.
Merci pour ce billet et ces extraits.
Merci Koz pour ce très beau billet.
Et merci aussi, Koz de faire prendre conscience à vos lecteurs
C’est d’une telle évidence que cela échappe à nombre d’entre nous qui ne voient dans cette demande que celle de fin de vie rapide et non de rassurement, de respect, d’amour !
Je ne saurai répondre avec autant de poésie, moi la scientifique pure et dure !
J’essaierai malgré tout avec mes mots, avec ma rationalité et ma logique.
J’ai fait mes études de Soins Palliatifs à La fac de médecine de « Broussais – Hôtel Dieu », et le prof qui s’occupait de ce DIU était – peut être l’est il toujours – le Dr Lassaunière, chef de service de M de Hennezel à l’époque de « la mort intime ».
Néanmoins, à ma grande surprise à l’époque- car j’avais lu ce livre – il nous a mis en garde contre les situations « trop » idéales décrites.
Avec le recul et l’expérience, je réalise qu’il avait raison.
Ce livre ne parle pratiquement que des bonnes expériences.
Or, nous ne mourrons pas tous comme cela, même dans un service de soins palliatifs. Il y a des « belles » morts, au sens où nous l’entendons aujourd’hui , et de moins belles.
Non pas tant à cause de la douleur physique, qui est maintenant bien traitée, mais à cause de la souffrance globale de l’être.
Et si nous pouvons aider à diminuer cette douleur, là, nous ne pouvons pas tout.
Je pourrais vous raconter les belles expériences que j’ai vécues. Elles m’ont nourrie, elles me nourrissent encore et me permettent de vivre mieux les moins bonnes.
Ce sont elles qui me font penser que les Soins Palliatifs sont nécessaires.
Cependant, elles côtoient les moins bonnes, celles qui nous font nous remettre en question celles qui nous font réfléchir, celles qui nous permettent d’accéder à l’humilité, à l’acceptation du fait que nous ne sommes pas tous puissants, que nous ne pouvons – et ne devons – pas influer pour que la mort de l’autre se passe telle que nous le voudrions – ou que nos croyances ou notre imaginaire le voudraient.(et là, je rejoints Carredas)
Nous ne sommes plus dans le faire, mais dans le « laisser faire », nous sommes dans l’être. Hormis cette petite distinction, sans nul doute M de Hennezel a fait un travail incommensurable dans le domaine de la prise en charge des personnes en fin de vie. Simplement, il faut accepter que nous ne mourrons pas tous ainsi et les accompagnements qui nous paraissent réussis nous permettent de continuer notre tâche.
Son livre (ses livres et son énorme rapport) nous montre la voie à suivre : reprendre le chemin du souci de la personne, le chemin du « laisser être », le chemin de l’écoute : Accepter le désir de la personne en fin de vie d’être reconnu, malgré l’évidence de la perte d’avenir.
C’est là aussi la beauté de l’accompagnement: la beauté de l’humilité que nous devons avoir. La beauté de l’empathie qui consiste à ne pas vouloir devancer le malade sur son chemin vers sa mort, mais plutôt à s’adapter à son rythme.
C’est accepter les mécanismes de défense que le malade met en place pour combattre son angoisse face à sa mort prochaine, c’est les accueillir tels qu’ils sont pour qu’ils ne soient pas remplacés par d’ autres plus inconfortables pour nous et le malade lui-même et qu’ils ne fassent pas écho aux nôtres, ce qui provoquerait de notre part une identification à l’autre avec tout ce que cela peut induire de fausses croyances, de fausses déductions, de fausses interprétations (nous faisons alors ce que nous voudrions qu’on nous fasse et non pas ce que l’autre voudrait qu’on lui fit)
C’est également là que nous devons nous pencher sur l’éthique, sur la réflexion philosophique, sur la réflexion spirituelle de la fin de vie.
Se pencher sur « le sens de l’action » à partir des résultats auxquels le malade voudrait arriver. Et là, nous devons admettre que chacun donne à sa vie un but différent, chacun peut répondre différemment à ces questions fondamentales : « quel est le but de l’existence, quel est le but de ma vie ».
En fonction de ces réponses, la fin de vie sera approchée de manière divergente.
De même la réponse à la question « y a t il quelque chose plutôt que rien » (réf à Leibniz), induira un comportement nuancé.
La mort nous angoisse en ce qu’elle est, en ce qu’elle semble couper les liens qui nous relient à l’Autre, à nous même, au point de nous amener à une perte de notre identité, ce « néant de l’identité » dont parle le philosophe J-P Sauzet, qui nous fait dire « je ne suis plus rien ».
Et c’est là que l’écoute est fondamentale : Ecouter sans que cela fasse écho à nos propres peurs et notre propre angoisse. Ecouter aussi les silences, sans vouloir les remplir par des paroles ou des gestes. Simplement écouter la vulnérabilité de l’autre, la profondeur de son angoisse, mais aussi la beauté de son être, ce qu’il nous dévoile de lui, en acceptant notre propre vulnérabilité.
Il ressort du livre de M de Hennezel, la bonté inhérente aux soignants des SP, certes. Néanmoins, ce qui me gêne dans votre billet, cher Koz, c’est cette notion de bonté.
Bonté : « penchant à faire le bien », « bienveillance ».
Penchant à « faire » le bien.
J’apprécie l’explication que vous donnez ensuite à Carredas, que je préfère, du « prendre soin », du « libérer la parole et le geste », parce « qu’à tout instant, il peut se passer quelque chose » de fort pour le malade (et pour nous-mêmes).
Ce n’est pas de la bonté que d’avoir des attentions qui paraissent inutiles, comme un décor, une assiette bien préparée, pour quelqu’un en fin de vie. Nous le faisons normalement pour quelqu’un dont nous croyons qu’il va vivre longtemps et que nous aimons et/ou respectons. Pourquoi serait ce devenu de la bonté lorsque cette personne va mourir? C’est aussi « normal » et évident, pourtant! Dire que c’est de la bonté tendrait alors à faire un clivage entre le temps de la mort – où tout acte normal devient acte de bonté – et le temps de la vie – où tout acte de respect de la dignité de l’autre devient «normal» ?
C’est discriminant, pour reprendre un mot à la mode!
Nous sommes dignes d’attention à tout moment de notre vie, d’autant que nous sommes – peut être – plus proche de notre mort que le malade en phase palliative au fond de son lit. Qui sait?
Et ne devrions-nous pas « laisser le temps au temps » aussi à ceux qui ont une longue espérance de vie? Vivre le temps présent, pleinement? Cueillir les joies qui passent, les savourer pleinement, dès la première minute de notre existence, au lieu d’attendre les dernières minutes?
Je crois que les soins palliatifs ne sont pas qu’une façon de vivre l’approche de la mort, mais une façon de VIVRE.
Pour ceux qui disent : « j’aimerais mourir ainsi « , je répondrais que c’est de leur responsabilité et non de celle des soignants, même s’il faut bien sûr quelqu’un pour partager ces intenses moments. Meurt-on comme on a vécu? Je n’irai pas jusque là. Néanmoins, je crois que la mort se prépare tout au long de la vie. Et pour avoir partagé nombre de fois cette expérience avec «mes» patients, je peux dire qu’une vie pleine, riche, ouverte aux autres amène à une mort riche, pleine, épanouissante, nourrissante, malgré les doutes et les peurs inévitables devant l’inconnu.
Le temps de la mort est une période privilégiée pour la rencontre, parce que ne pouvant plus nous projeter dans le quantitatif, nous favorisons alors le qualitatif.
Dans l’accompagnement, nous ne sommes pas dans la bonté – même si, pour certains, ce peut être sa définition-, mais dans l’authenticité.
Authenticité qui va beaucoup plus loin que la bonté. L’accompagnement est du ressort du transcendant, du partage de la dimension symbolique de l’autre, au cours de notre rencontre mutuelle:
Authenticité qui est un mélange de vulnérabilité – acceptation d’être touché par l’autre-, de simplicité – être ce qu’on est -, de « nudité » – accepter de se montrer tel qu’on est, d’humilité – être ce qu’on est, ni plus, ni moins.
Pouvoir « Vivre le mystère de la mort.» ensemble. Tel est, pour moi, l’essence même de l’accompagnement.
Merci Koz, très beau billet, mais que dire des femmes qui meurent sans avoir eu le temps d’y réfléchir: « Les activistes parlent de « génocide » contre les femmes, au nom de la religion…. en Irak »
Salut,
Je tenais, pour ma part, à insister sur les jolies phrases de Mme de Hennezel,
, je trouve qu’elle illustre très bien, en les évoquant de loin, le fait que notre société vit de malheurs et de « dépressions » à cause de cette sempiternelle célérité dans tout ce que nous faisons, tant au travail que dans la vie.
Car à cause de celle-ci, nous courrons vers notre mort, vers son mystère. Nous l’appréhendons par souci d’efficacité.
Nous sommes malheureux d’oublier le mystère de la mort, sa beauté, ou autre chose qui nous échappe.
J’ignore si c’est vraiment le message que Mme de Hennezel a essayer de véhiculer, mais je suis sûr que cette vision quotidienne de la vie en présence de ceux qui vont mourir doit être extrêmement enrichissante.
Merci Koz pour ce joli billet.
@Xime
je crois qu’il s’agit d’un texte de Tonton.
cf billet: mardi c’est philo
@Koz: merci
Dans la même veine on peut lire le livre du père Denis Ledogar qui a accompagné les sidéens en phase terminale aux hospices civils de Strasbourg
On n’a pas le droit de douter un instant de la sincérité des uns et des autres ici : Marie de Hennezel, Koz et les commentateurs. Sauf qu’il s’agit à chaque fois de la mort de autres, pas de la nôtre, et pas de la nôtre au moment où nous la vivons. Qu’en sera-t-il, comment passerons-nous de la théorie à la pratique quand elle arrivera ?
Texte à propos de l’extraordinaire « Dialogue des carmélites » de Georges Bernanos :
http://kozlika.org/kozeries/index.php/2004/12/03/110-dialogues-carmelites
JD écrit, ci-dessus :
Oui, effectivement et je dirais presque même : bien sûr. Je ne suis pas en mesure d’assurer que, le jour venu, je n’en viendrai pas à hurler d’angoisse et à réclamer à toute force qu’on mette fin à ma vie et à mes douleurs. Et je n’ai pas envie de me leurrer à ce sujet.
La relativité de nos positions atteint tout le monde. Elle atteint aussi ceux qui, en pleine santé, réclament la légalisation de l’euthanasie.
Elle atteint un peu moins Marie de Hennezel qui a accompagné des mourants pendant dix ans.
Au demeurant, elle a, notamment, évoqué cette question avec François Mitterrand (l’auteur, effectivement, de la préface), qui lui demandait si on mourait comme on vivait. Et elle lui répondait qu’elle avait vu des prêtres perdre la foi au seuil de la mort et des personnes, au contraire, faire acte de foi.
Quant à moi, je regarde deux hypothèses, dont le point de départ commun est de considérer que l’on se trompe sur ce que l’on souhaitera le moment venu :
1. j’affirme mon choix de l’euthanasie, et la société évolue dans ce sens. Mais le jour venu, ce n’est plus la décision que je voudrais privilégier. Sauf qu’on me l’accorde malgré tout. On me répondra qu’il y aura des garde-fous. J’émets des doutes.
2.j’affirme mon refus de l’euthanasie, et la société évolue dans ce sens. Mais le jour venu, je la réclame. Sauf qu’on m’applique les soins palliatifs malgré tout…
Je crois que je préfère qu’on me laisse la vie contre mon choix plutôt qu’on me la retire.
Et ma crainte, c’est que, par un petit jeu trop humain, trop facile, l’euthanasie ne prospère sur le dos des soins palliatifs. Et non, je n’ai pas de boule de cristal pour vous prouver que c’est exact mais cette évolution me paraît plus que probable. Notamment au vu de ce qui motive notre société.
Xime,
Je serais prudent sur la beauté de la mort. Je préfère dire que sa réalité n’est pas que funeste.
Tara, tes commentaires sont des billets à eux seuls.
J’avoue que la possibilité que Marie de Hennezel ne rapporte que les plus « beaux » cas m’a effleuré. Au demeurant, elle rapporte aussi une sorte de « raté » : un homme homosexuel d’une quarantaine d’années, qui n’avait jamais parlé de son homosexualité à ses parents, et qui n’a pas pu le leur dire, ceux-ci le sachant (leur fils avait demandé à Marie de Hennezel d’aborder le sujet) et refusant de l’entendre. D’une certaine manière, il aura réussi, avec une autre personne, à évoquer sa vie, mais ce dialogue-là n’aura pas pu se faire.
Elle mentionne aussi, chemin faisant, les hurlements d’angoisse de certains.
Mais son livre ne me semble pas vouloir être absolument exhaustif. Il est sous-titré « ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. Or, quelle est l’attitude aujourd’hui commune sur la mort, sinon le rejet, le déni, la volonté d’abréger ? Elle veut montrer ce que peut aussi être la mort.
La bonté, Tara, ce n’est pas moi qui la relève, c’est une malade qui le suggère.
Et si, effectivement, on devrait considérer qu’il devrait être normal de prendre soin des autres, de ceux qui souffrent, de ceux qui meurent, il reste, il me semble, qu’au vu du comportement ordinaire, il y a de la bonté. Et ce d’autant plus que c’est accompagné d’une véritable attention.
Si telle est ton expérience, il ne reste plus qu’à soigner notre vie.
Koz vous écrivez, entre autres : » j’affirme mon choix de l’euthanasie, et la société évolue dans ce sens. Mais le jour venu, ce n’est plus la décision que je voudrais privilégier. Sauf qu’on me l’accorde malgré tout. On me répondra qu’il y aura des garde-fous. J’émets des doutes. »
J’apprécie votre « je », car il renvoie à soi, à son choix, à cela seul qu’on ne saurait ni abandonner sous la contrainte ni imposer aux autres ; et je vais le reprendre, ce « je ».
Et j’affirme moi aussi ce choix car je suis arrivé à un âge où la question peut se poser ; où je sais aussi que je peux avoir une absolue confiance en mes deux enfants, qui ne laisseront aucune tierce personne se mêler de décider à notre place.
Je ne sais plus bien à quel choix vous faites référence mais, puisque vous souligniez tout à l’heure ceci :
… pouvez-vous être certain, si certain, de ce que ce que vous avez dit à vos deux enfants correspondra précisément à ce que vous penserez à ce moment-là, à ce que vous penserez et exprimerez, ou à ce que vous penserez mais n’arriverez pas à exprimer, par un empêchement physique ou psyhcologique ?
Pour le reste, il est vrai qu’en ce qui me concerne, je m’en tiens à un principe qui ne me semble pas aberrant, à savoir que le respect de la vie prime sur le respect d’une volonté de mourir, que je préfère vivre contre mon gré (avec peut-être une évolution insoupçonnée) que mourir contre ma volonté.
Mon choix (et celui que je n’imposerais à personne d’autre) est du refus de l’acharnement thérapeutique.
Vous me demandez : « … pouvez-vous être certain, si certain, de ce que ce que vous avez dit à vos deux enfants correspondra précisément à ce que vous penserez à ce moment-là, à ce que vous penserez et exprimerez, ou à ce que vous penserez mais n’arriverez pas à exprimer, par un empêchement physique ou psychologique »
Bonne question. Je ne suis certain de rien, si ce n’est de leur aptitude à me respecter tel que je suis et serai et serais. Et je n’ai pas l’intention de faire un locked-in 😉 Je serais même, à la vérité, un peu comme Brassens qui dit :
« J’aim’rais mieux mourir dans l’eau, dans le feu, n’importe où
Et même, à la grand’ rigueur, ne pas mourir du tout
@Tara,
Votre commentaire, à mes yeux, est exceptionnel.
J’ai ressenti chacun de vos mots comme des connaissances instinctives qu’on lirait clairement et supérieurement formulées pour la première fois.
Vous parliez d’authenticité. Vous nous en avez livré un container entier. Merci.
Sur le choix de l’euthanasie vs une fin de vie accompagnée.
Je vous conseille la lecture du livre d’entretiens entre Axel Kahn et Christian Godin : L’homme, le bien, le mal Ed. Stock.
Dans le chapitre intitulé « de la conception au trépas », A. Kahn et C. Godin tentent d’approcher la fin de vie sous tous ces aspects (médical, moral, légal etc.)
De nombreux exemples cités apportent un éclairage qui me semble aller dans le sens de Marie de Hennezel : développement des soins palliatifs, réduction maximum de la souffrance, primauté de la vie par rapport à une mort accélérée (même de quelques jours).
Concernant la perception de l’euthanasie dans notre sociéte :
Extrait (p.271):
D’où les dangers d’une nouvelle loi qui renforcerait la norme, de par sa simple promulgation : même avec un texte ne légalisant pas l’euthanasie, le fait de légiférer sur le sujet ne ferait que renforcer l’idée -aujourd’hui semble-t’il largement répandue dans l’opinion ou en tout cas relayée comme telle par les media- que l’euthanasie est la seule solution à des situations de très grande détresse.
Les personnes dans ces situations et leurs proches méritent notre compassion, notre effort (individuel et collectif) pour atténuer leur douleur, mais également notre protection pour la préservation de leur être face à un geste sans retour.
Même livre, même page
Merci de continuer à traiter de ce sujet quand il n’y a plus de déchainement médiatique. Ca y est, la grosse machine s’occuppe déja d’aute chose. Sébire est passée, on zappe… On y reviendra quand on aura toujours pas reflechi. Et ainsi de suite.
On a beoin de pensée calme, de pensée durable pour apprehender un tel sujet. Merci de mettre en valeur les éclairages de M. de Hennezel.
On est de chair et d’os, mais on est aussi d’ame et d’esprit. Les materialistes pensent qu’y croire est infondé, arrieré. M de H nous montre que c’est là que l’inconditionnalité de notre dignité est ancrée. Pas dans l’apparence, pas dans le bien etre. Et qui pourrait la qualifier d’hyocrite? elle l’a bien vécu!
Merci donc pour ce billet
NB j’ai peut etre pas bien saisi l’esprit du billet d’anticipation précedent. Manque de « blog-experience » peut etre.
Philo, merci pour la référence. Je lirai volontiers.Je ne suis pas toujours d’accord avec Kahn mais en l’occurrence, vous vous doutez que je le suis. Et puis, j’apprécie de trouver le « renfort » de personnes de sensibilités différents, non suspects [;-)] de convictions religieuses.
J’aime assez la façon dont il formalise cela. Ne peut-on penser que ce qu’il dit s’appique à la société comme aux personnes mourantes, dans une certaine mesure ? Car même la personne mourante en vient à juger de sa propre dignité au regard des critères fixés par la société.
Adrien, en ce qui concerne mon précédent billet, il est clair qu’il vaut mieux ne pas tomber directement dessus sans connaître le blogueur avant. Je confesse que sa triste ironie n’est certainement pas spontanément perceptible.
Quant à continuer de traiter le sujet… Je suis tombé avant-hier, via webarchive, sur un billet que j’avais écrit en avril 2006 (si vous cliquez sur le tag « euthanasie », vous le retrouverez).Malheureusement, quelle que soit la réponse apportée, les pro-euthanasie utilisent chaque nouveau cas pour essayer de faire avancer leurs thèses. On a le sentiment que le débat est sans fin. Il faut s’y préparer.
Koz:
C’est exactement ce qu’il dit (l’individu intériorise la norme de la société et la fait sienne), bien qu’il ne s’agisse pas, dans ce paragraphe, du sentiment de dignité, mais plus de la possibilité pour chacun d’user librement de sa volonté.
Citation de C. Godin amorçant l’extrait que j’ai déjà donné :
Traduction : on considère que chacun peut avoir la volonté de mourir, et que l’expression de cette volonté vient d’un sujet libre et doit donc être respectée. Et dans le même temps on nie à cette même personne la possibilité de changer librement de volonté (à la fois par la pression normative indiquée par Kahn mais aussi parce qu’un mort ne peut plus changer d’avis).
Le risque (c’est moi qui parle) étant de répondre trop vite à une demande d’euthanasie alors que le changement d’un certain nombre de paramètres de la situation pourrait changer la volonté de l’individu concerné ou la volonté de ceux en charge de porter la volonté de l’individu.
Ok, Philo. C’est encore plis clair à la lumière de cette autre citation.
Adrien, sur la nécessité de réagir sereinement, un constat : cela peut s’expliquer par de multiples raisons, dont la moindre n’est pas les vacances mais tu reléveras le nombre modeste de commentaires à ce billet et l’absence de contradiction. Pourtant, lorsqu’un cas médiatique se présentera, ce sera de nouveau la déferlante. Et chacun de réaffirmer alors une position qu’il considèrera comme mûrement réfléchie, quand elle ne se confronte en fait majoritairement qu’à chaque nouveau cas opportunément présenté. Mais entretemps, que font-ils ?
Koz, je ne suis pas aussi positive que vous au sujet du livre de MDH. Également au sujet d’une tribune écrite par MDH, que j’ai lue dans Le Monde, il y a peu.
Je rejoins assez la position de carredas (29-04, 11h53).
En fait, je crains qu’à un humanisme et à une morale qui puisent leurs sources dans des traditions classiques, ne se substitue une sorte d’humanisme light qui ne serait que trop dans la veine du psychologisant à tout prix.
Je ne vous suis pas. Je ne comprends d’ailleurs pas bien la teneur du reproche que vous faites. Je ne suis pas très penché sur la psychologie. Par éducation et habitude. En revanche, j’accepte tout à fait l’idée de l’importance de ressorts psychologiques et de leur impact sur notre état physique et, encore plus évidemment, psychique.
Par ailleurs, Marie de Hennezel est psychologue. Il me semble assez logique que son livre retrace essentiellement l’aspect psychologique.
Le classicisme des sources de l’humanisme en question ne me semble pas davantage un argument. Je ne vois pas de raisons de penser que l’humanisme qu’elle met en avant soit exclusif d’un autre. Au demeurant, elle fait référence parfois à une spiritualité plus classique dans laquelle elle puise probablement une certaine force sans la porter en étendard.
carredas, le 29.04.08, 11:53
Je viens seulement, honte sur moi, de lire ce texte que je signe des deux mains dans sa totalité, bien qu’incroyant.
Il me renvoie à la façon dont notre père a agonisé paisiblement pendant huit jours, nous donnant le temps de prendre congé chacun à notre rythme.
Si vous voulez, et beaucoup d’autres comme vous.
Et vous êtes entendus, compris, respectés, et on vous accompagne comme vous le souhaitez.
Je crois viscéralement que je préfère le contraire, et beaucoup d’autres comme moi.
Et ??…
Koz, bien sûr que l’humanisme de MDH n’est pas exclusif d’un autre.
Mais l’idée que nous devrions ne plus savoir nous passer de la psychologie pour former correctement des soignants, dont le métier est d’être, d’entrée, confronté, à la maladie et à la mort, me met mal à l’aise.
Thaïs évoque plus haut le livre » Un homme » de P. Roth.
Je pense qu’une formation à vocation humaniste ne peut simplement pas faire l’impasse sur ce que, par exemple, la littérature a à nous dire sur le sujet.
Mon souci, c’est qu’il me semble que la démarche de MDH adapte dans le langage psy, des enseignements tels que ceux de l’art, de la littérature ou de la religion ont construit et construisent depuis fort longtemps.
Koz, je souhaite également vous dire .
Sachez que je lis le plus régulièrement possible votre blog. C’est la sérénité de votre ton que j’apprécie particulièrement.
Mais faute de temps, je ne peux pas traduire en commentaires la réflexion que m’inspirent vos notes, celles de vos invités et les commentaires qu’elles suscitent
Je ne poste jamais dans les blogs « modérés » !
Pingback: Koztoujours, tu m’intéresses ! » Exil des enfants autistes, bannissement des adultes
Oui, la dignité, c’est sans doute la réponse.
La dignité nécessite de lutter contre la douleur qui rend fou ;
la dignité nécessite une équipe intelligente et bien formée qui ne transforme pas le mourant en vieil enfant ;
la dignité nécessite d’aider à retrouver ce qu’il y a de plus riche dans chacun de nous qui mourrons tous ;
Et pour retrouver tout cela il faut aller « au delà » c’est peut-être un peu aussi le sens de cette expression, le lieu du mystère mais aussi le dépassement pour ceux qui le souhaitent….ils faut les y aider ! L’on ne soulignera jamais assez le rôle de ces accompagnateurs des « soins palliatifs » à qui nous devons le respect !
Un respect qui nécessite aussi de leur permettre de pouvoir retrouver de l’oxygène pour eux-mêmes, l’on ne peut toujours donner !